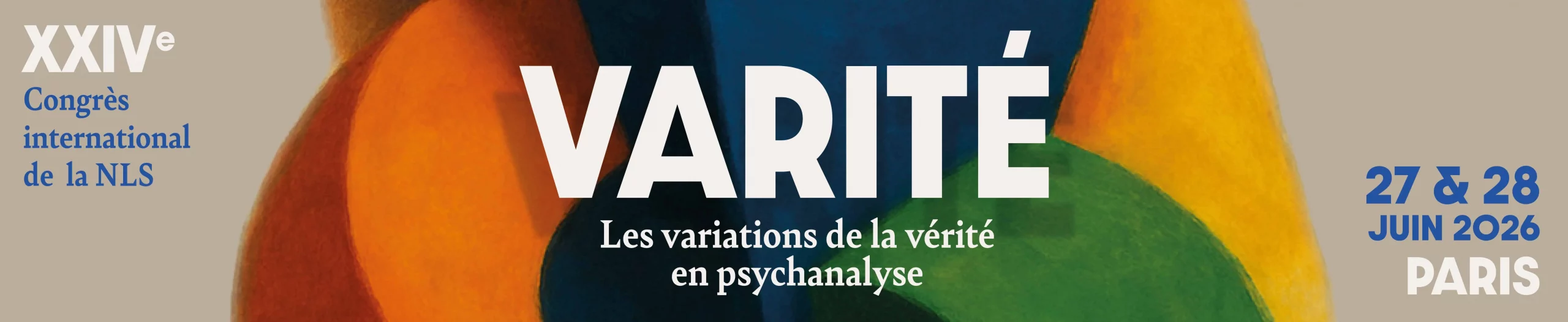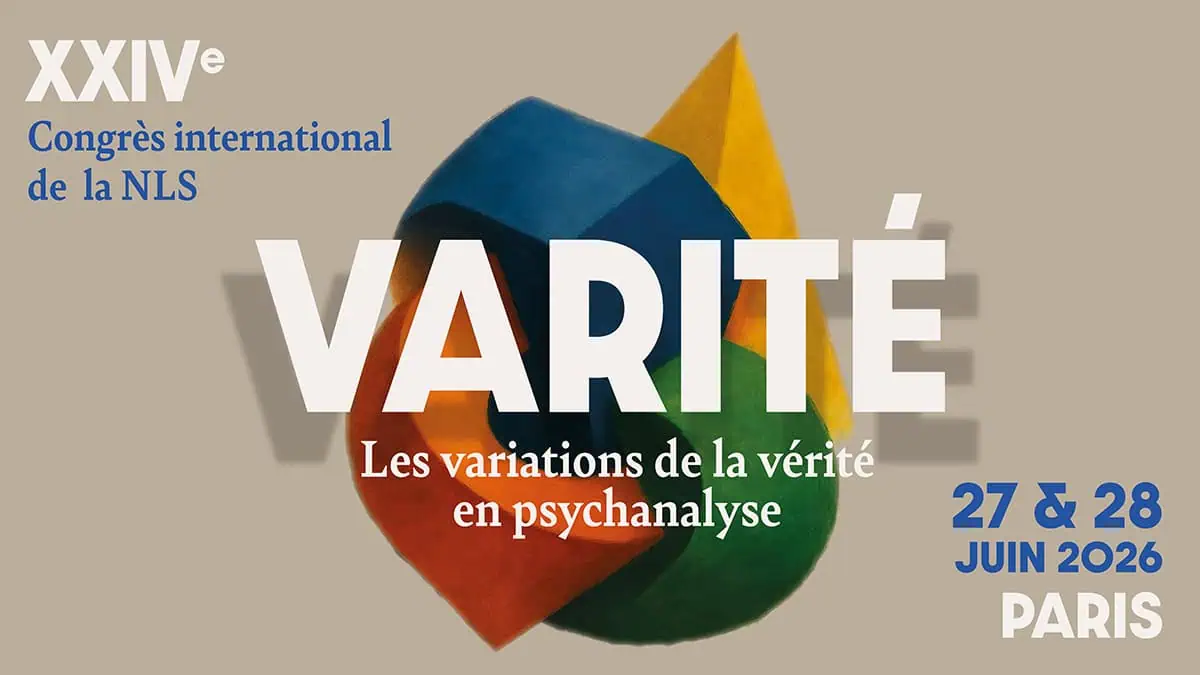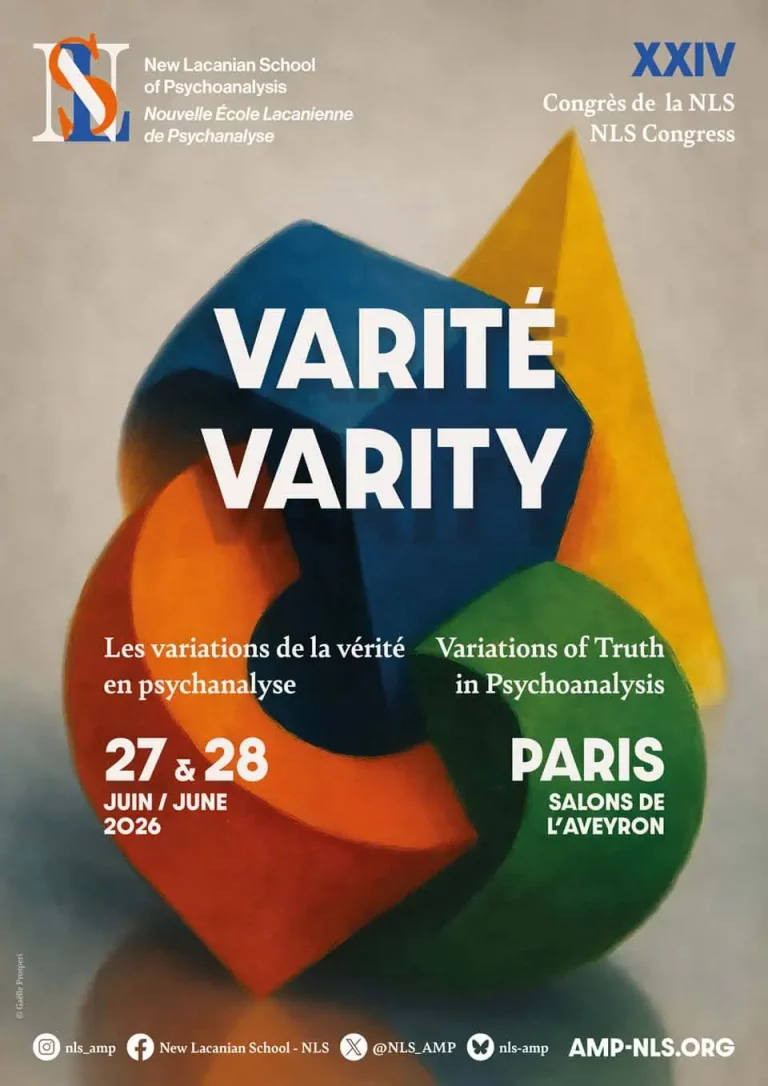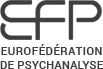Par Patricia Bosquin-Caroz
VARITÉ
Les variations de la vérité en psychanalyse
« Je dis toujours la vérité : pas toute, parce que toute la dire, on n’y arrive pas. La dire toute, c’est impossible, matériellement : les mots y manquent. C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel ».
Jacques Lacan, Télévision
Le XXIVe Congrès de la NLS se propose d’interroger les variations de la vérité́ en psychanalyse. Lacan a condensé dans le néologisme varité[1] les variations de la vérité́ qui se produisent dans une analyse au gré́ des révélations successives. Il énonce qu’il faudrait s’ouvrir à la dimension de la vérité́ comme variable et ajoute que ce que l’analysant dit, ce n’est pas la vérité́ mais la vari(é)té du sinthome. Tout au long de son enseignement, Lacan n’a jamais abandonné la référence à la vérité́, qu’il l’ait d’abord abordée comme La vérité́ ou, plus tard, comme vérité plurielle, variable et menteuse. Toutefois, une constante demeure : l’articulation de la vérité ou des effets de vérité avec la structure du langage et de la parole, voire du « bouillon de langage[2]».
Vérité, exactitude et révélation
Au départ, Lacan met en valeur une autre dimension de la parole que celle de l’expression et de la médiation : la révélation. La révélation se rapporte au dévoilement d’une vérité supposée cachée, voilée et coïncide avec l’instant de voir. Ainsi la vérité va de dévoilement en dérobade ou échappée, tandis que l’analyse se définit comme une série de révélations particulières à chaque sujet. Dans son texte fondateur, « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse[3] », Lacan oppose la parole pleine à la parole vide ; la parole pleine étant celle où se réalise la vérité du sujet. Dans cette perspective, la vérité de la révélation concerne la vérité dans la parole. « [P]ar là nous nous heurtons à la réalité de ce qui n’est ni vrai, ni faux[4]». La réalité se distingue ici de la référence à l’exactitude et ne renvoie à aucune conformité́ à une réalité objective. La vérité d’une parole ne se fonde pas dans l’adéquation du mot à la chose. Freud, lui-même, au bout de longues recherches, avait fini par renoncer en la croyance à la réalité objective des traumatismes qui, dans l’inconscient, ne se distingue pas « de la fiction investie d’affect[5] ». Ce que Jacques-Alain Miller formulera comme suit : Dans l’analyse, il ne s’agit « pas de dire ce qui est », mais « il s’agit de faire vérité de ce qui a été. Et il y a ce qui a manqué́ à faire vérité : les traumatismes, ce qui a fait trou […] Il s’agit de faire venir le discours à ce qui n’a pas pu y prendre rang[6] ».
Mais, surtout, Lacan va situer le nouveau de la découverte freudienne au regard de ce qui fait irruption dans le discours du sujet qui, lui, « se développe normalement […] dans l’ordre de l’erreur, de la méconnaissance, voire de la dénégation[7]». La vérité́ surgit de la méprise, du lapsus, de l’acte manqué, de ce qui achoppe et qui « [révèle] une vérité de derrière », un autre sens. Elle émerge sous le mode du trébuchement qui rompt le cours de la narration du sujet et le dépasse. « La vérité rattrape l’erreur au collet dans la méprise[8]». Ce qui signifie que le sujet ne sait pas ce qu’il dit, il en dit toujours plus que ce qu’il ne veut en dire, toujours plus que ce qu’il ne sait en dire.
Vérité, refoulement et histoire
Comme J.-A. Miller le spécifie dans son texte « Une nouvelle alliance avec la jouissance[9] », pour Lacan, une analyse consistait d’abord pour le sujet en un progrès de La vérité au singulier, c’est-à-dire supposée s’inscrire dans la continuité́ d’une histoire. Le terme d’histoire, tel que Lacan s’y réfère dans « Fonction et champ de la parole et du langage », répond à celui d’inconscient. « L’inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge : c’est le chapitre censuré[10] ». Dans l’analyse, il s’agit de reconstituer cette histoire. Les levées méthodiques du refoulement, les levées de voile permettent alors d’en restaurer la continuité́ et de retrouver la vérité́ cachée. L’expérience de Freud avec les hystériques l’avait conduit à ne pas confondre la mémoire biologique avec la remémoration, qui concerne l’histoire reconstruite du sujet. Celle-ci implique la resubjectivation de l’événement et sa restructuration dans l’après-coup. C’est pourquoi Lacan a d’abord défini la psychanalyse comme étant l’assomption par le sujet de son histoire, en tant qu’elle est constituée par la parole adressée à un autre.
À propos du cas Dora, il évoquera plus tard l’expression « développements de la vérité », participant aux « renversements dialectiques[11] » et donc au progrès de l’analyse. Refoulement et vérité sont alors des antonymes. « [L]e concept de refoulement est appelé, exigé, convoqué par l’expérience de la révélation[12]». Mais dans son retour à Freud, Lacan va surtout réinstaurer le soc tranchant de sa découverte, qui s’éloigne de la véracité des faits. Dans « La chose freudienne », il précisera que la découverte essentielle de Freud consiste à affirmer que « ça parle, et là sans doute où on s’y attendait le moins, là où ça souffre[13] ». « Moi la vérité, je parle[14] ». Soulignons ici que cette assertion relève avant tout d’une énonciation et non pas d’un énoncé moïque affirmant une conviction personnelle contre la doxa universelle.
Vérité et savoir
Lacan a commencé par opposer la vérité au savoir et fait valoir la primauté de la vérité sur le savoir. La référence, notamment au paradoxe du Ménon, lui servira à soutenir que « l’épistémè, le savoir lié par une cohérence formelle, ne couvre pas tout le champ de l’expérience humaine[15]». À propos de l’alèthès doxa, de l’opinion vraie, Lacan notait qu’« il y a là un vrai qui n’est pas saisissable dans un savoir lié[16]». À l’instar du procédé dialectique à l’œuvre dans ce dialogue entre Ménon et Socrate, Lacan soulignait la dimension créatrice et émergente de la vérité dans laquelle nous travaillons, qui n’est pas celle d’un savoir déjà̀ constitué.
Renversement
Lacan ne maintiendra pas cette opposition entre vérité et savoir. Il faudra attendre sa « Proposition sur le psychanalyste de l’École » pour voir apparaître une articulation entre les deux qu’il formalisera dans le mathème du discours analytique. Vérité et savoir ne se laissent pas répartir en deux classes. « [C]e qui, au moment naissant, se présente comme vérité, devient savoir en s’enregistrant et en se déposant[17]». La Proposition de la passe s’inscrit dans cette perspective d’un savoir sur la vérité inconsciente. La vérité se présente d’abord comme un non-savoir, elle se manifeste par l’association libre et finit par prendre la forme d’un savoir. « [Ç]a s’articule en chaîne de lettres si rigoureuses qu’à la condition, énonce Lacan, de n’en pas rater une, le non-su s’ordonne comme le cadre du savoir[18] ». Lacan établit également en termes de savoir la mutation à l’œuvre à la fin de l’analyse de l’être du désir à celui du savoir. On le remarque, il n’est plus question de la vérité qui dit je parle, mais « d’une vérité enchainée, vidée de signification et, par là même, de passion[19] ». Le dispositif analytique consiste alors à recueillir les signifiants qui ont une valeur de vérité, ceux qui ont compté́ pour le sujet. Il implique l’acte de l’analyste pour les isoler.
Pourtant, Lacan finira par dévaloriser le savoir quant à l’abord du réel. Dans son Séminaire Encore, il évoquera le terme d’« élucubration de savoir sur lalangue ». La structure du langage est alors ramenée à la fiction, tandis que l’inconscient est appréhendé comme « un savoir-faire avec lalangue[20] » . Mais alors que devient la vérité ? Quid des révélations ?
Vérité menteuse et fiction
Les effets de révélation jalonnent le parcours analytique jusqu’à un certain point. Ils indiquent que la vérité se produit dans la parole ; c’est pourquoi Lacan a soutenu que la vérité a structure de fiction. D’emblée, il avait précisé que le terme de fiction ne représente rien d’illusoire ou de trompeur. Le caractère de fiction des mythes et des théories sexuelles infantiles en témoigne. La structure narrative de leur récit permet en effet d’aborder des thèmes comme ceux de la mort, de l’existence et de la non-existence, c’est-à-dire ce qui est de l’ordre de l’indicible. De même, elle constitue une dimension essentielle de l’expérience analytique. Pourtant, l’analyse peut être poussée jusqu’au registre où la vérité n’a plus cours : la jouissance, point de butée de la narration charriant les révélations. On ne peut pas dire le vrai sur la jouissance ni dire toute la vérité. À ce propos, on peut remarquer que Lacan n’a jamais cessé d’aller contre l’idée d’une transparence des mots avec la Chose ni d’appréhender la vérité comme un tout. On ne peut que tourner autour ou la mi-dire. Par conséquent, la parole instaurée par le discours analytique relève de la fiction, de la vérité menteuse. Le langage est semblant et, au regard du réel, il ne peut que mentir. Freud avait déjà relevé la fonction du proton pseudos dans le cas Emma. Mentir, ne se rapporte donc pas à une opposition entre le véridique et le mensonge.
Lors de son premier Séminaire, Lacan soulignait déjà̀ que la parole se déploie dans la dimension de la vérité trompeuse. La vérité est mensonge car elle dépend de la narration, de la construction, du sens que l’on donne aux évènements. La référence au texte « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », où Lacan évoque le terme de vérité menteuse, pourrait se lire en contrepoint de « Fonction et Champ… », comme J.-A. Miller nous avait déjà̀ invités à la faire. Lacan y mentionne un autre registre où la vérité n’est plus de mise sinon qu’à mentir, celui de la jouissance et de sa satisfaction. La vérité menteuse devient alors élucubration de savoir sur le réel, ce qui n’empêche pas que des effets de vérité se produisent et que l’analyste y soit attentif. « [L]a psychanalyse, c’est ce qui fait vrai, mais faire vrai, comment faut-il l’entendre ? C’est un coup de sens, un sens blanc[21] », dit Lacan.
Vérité, discontinuité et variations
Pour Lacan, la vérité ne va donc pas sans une narration qui restitue une continuité de l’histoire du sujet donnant sens à ce qui n’a pu se dire ou mal se dire. La narration « [prend] en charge ce qui est resté comme trou dans la réalité du sujet [afin de faire] sens de ses traumatismes, de ses images indélébiles, de ses scènes monumentales[22] ». Il s’agit de rétablir une continuité entre les trous en racontant une histoire pour un autre. Mais à l’idéal d’une histoire restituée dans sa continuité, Lacan va finir par substituer la conception d’une histoire discontinue faite de bouts épars, d’éclats, d’émergences, de révélations. La discontinuité narrative remet en question l’idée d’une vérité unique et univoque. « L’articulation même du discours analytique conduit l’analysant à construire, à tisser une trame de vérité menteuse, une trame de vérité variable, changeante, de vérité qui bascule incessamment dans le mensonge, qui n’est que transitoire, et à tisser cette trame à partir des contingences passées et des contingences quotidiennes[23] ».
Ainsi, dans une analyse, se succèdent des révélations remettant parfois en cause les précédentes. D’ailleurs, par ses scansions et ses ponctuations, l’acte de l’analyste participe de la variation de la vérité. C’est ainsi que l’inconscient prend sens et que ce sens ne cesse de se réinterpréter différemment. La vérité́ varie, se pluralise, tandis que l’hystoire s’appréhende désormais comme celle qui se construit pour un autre dans une dimension transférentielle. Il n’y a pas de continuité idéale, mais une histoire transférentielle et singulière.
Ce qui est sûr, c’est que la varité, les variations de la vérité demeurent une préoccupation de la psychanalyse. À l’ère de la post-vérité́, elle va à contre- courant du discours ambiant où la référence à la vérité a disparu avec, comme corollaire, la dévaluation et même la dégradation de la parole. L’enjeu de notre congrès sera de faire valoir la dimension éthique du rapport des sujets à la vérité, à la parole, condition même de leur analysibilité́. « L’épreuve de vérité, c’est l’analyse, où on essaye de dire le vrai, le compagnon analyste étant là pour vous inspirer une certaine passion de dire vrai[24] ».
Notes
- Lacan J., « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », leçon du19 avril1977, inédit. ↑
- Ibid. ↑
- Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, Paris, Seuil, 1966. ↑
- Ibid., p.256. ↑
- Freud S., Lettres à Wilhelm Fliess, 1887–1904, Paris, PUF, 1956, lettre 69 du 21 septembre 1897, p. 191. ↑
- Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université́ Paris 8, cours du 18 mars 2009, inédit. ↑
- Lacan J., Le Séminaire, livre I, Les Écrits techniques de Freud, texte édité́ par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1997, p. 291. ↑
- Ibid., p. 292. ↑
- Cf. Miller J.-A., « Une nouvelle alliance avec la jouissance », La Cause du désir, n° 92, avril 2016. ↑
- Lacan J., « Fonction et champ… », op. cit., p. 259. ↑
- Lacan J., « Intervention sur le transfert », Écrits, op. cit., p. 219 & 216. ↑
- Miller J.-A., « La vérité fait couple avec le sens », La Cause du désir, n° 92, op. cit, p. 87. ↑
- Lacan J., « La chose freudienne », Écrits, op. cit., p. 413. ↑
- Ibid., p. 409. ↑
- Lacan J., Le Séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1978, p. 26. 16. Ibid. ↑
- Ibid. ↑
- Miller J.-A., « Le paradoxe d’un savoir sur la vérité », La Cause freudienne, n° 76, décembre 2010, p. 124. ↑
- Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 249. ↑
- Miller J.-A., « Le paradoxe d’un savoir sur la vérité », op. cit., p. 129. ↑
- Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 127. ↑
- Lacan J., « L’insu que sait… », op. cit., leçon du 10 mai 77. ↑
- Miller J.-A., « La vérité fait couple avec le sens », op. cit., p. 88. ↑
- Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse », op. cit., cours du 11 février 2009. ↑
- Miller J.-A., « La passe bis », La Cause freudienne, n° 66, juin 2007, p. 211. ↑